Commandée par le guitariste français Jérémy Jouve et par le Listen Ensemble, L’Imitation du sommeil a été créée au Conservatoire de Musique et de Danse d’Aulnay-sous-Bois (France) le 12 mai 2015. Elle a été jouée pour la deuxième fois en France au théâtre Les Passerelles de Pontault-Combault le 13 décembre 2015. Il s’agit d’un concerto pour guitare expérimental. Il est écrit pour un soliste de guitare classique, un contre-ténor, un orchestre de chambre et une électronique générative à 4 canaux. Il n’y a pas de partition ; tous les musiciens jouent à partir d’ordinateurs portables contrôlés par un ordinateur central via un réseau Ethernet privé.
L’Imitation du sommeil dure environ une heure et se compose de dix sections qui se répètent de manière séquentielle tout au long de la représentation. Malgré cette répétition régulière, les effets électroniques génératifs garantissent que deux sections répétées ne seront jamais identiques. Chacune des dix sections dispose de sa propre collection de fichiers sonores. Lorsqu’une section commence, l’ordinateur choisit et combine différents fichiers sonores pour créer une texture électronique composite. Chaque fichier sonore choisi correspond à une version notée que le soliste et l’orchestre doivent jouer. Les versions notées de ces fichiers sonores sont affichées sur les ordinateurs portables des musiciens et synchronisées avec l’électronique. Le logiciel des musiciens affiche des instructions textuelles indiquant quand commencer et arrêter de jouer ; il comprend également une piste de clic. Représentation en France au théâtre Les Passerelles à Pontault-Combault le 13 décembre 2015. L’œuvre est un concerto pour guitare expérimental écrit pour un soliste de guitare classique, un contre-ténor, un orchestre de chambre et une électronique générative à 4 canaux. Il n’y a pas de partition ; tous les musiciens jouent à partir d’ordinateurs portables contrôlés par un ordinateur central via un réseau Ethernet privé.

Le matériel noté a d’abord été conçu pour la guitare classique, puis transformé ensuite en parties instrumentales pour les autres instruments. Ainsi, la partie de guitare solo est à l’origine de la musique pour le reste de l’ensemble. Par conséquent, le matériau joué par le soliste peut réapparaître plus tard dans d’autres instruments, selon les décisions prises par l’ordinateur. La variété générative de l’œuvre est renforcée par les multiples portées dans chaque partie notée. Celles-ci permettent aux musiciens de créer des versions hybrides de leurs parties en changeant de portée pendant qu’ils jouent.
Le contre-ténor a une fonction tout à fait différente dans L’Imitation du sommeil. À un intervalle déterminé par l’ordinateur, la musique générative des dix sections est interrompue par l’arrivée de l’une des quatre sonorités électroniques subtilement ondulantes. En fonction du choix de la sonorité par l’ordinateur, l’une des quatre « interventions » est choisie pour que le contre-ténor l’interprète avec le soliste à la guitare. Ces « interventions » consistent en de multiples variations de matériel vocal minimaliste, semblable à des chants, et de sonorités que le guitariste peut réinterpréter à sa guise. Les interjections intermittentes et surnaturelles du contre-ténor créent une ambiguïté quant à l’identité du soliste. Le contre-ténor est-il le « vrai » soliste ? Un soliste fantôme ? Mais même dans ces moments-là, c’est le guitariste qui contrôle : de manière presque imperceptible, le contre-ténor le suit.
Le titre L’Imitation du sommeil – un jeu de mots, à la fois « limitation » et « imitation » du sommeil – est tiré d’un court texte de l’obscur surréaliste belge Gaston Dehoy, publié dans la revue éphémère Distances en avril 1928 :
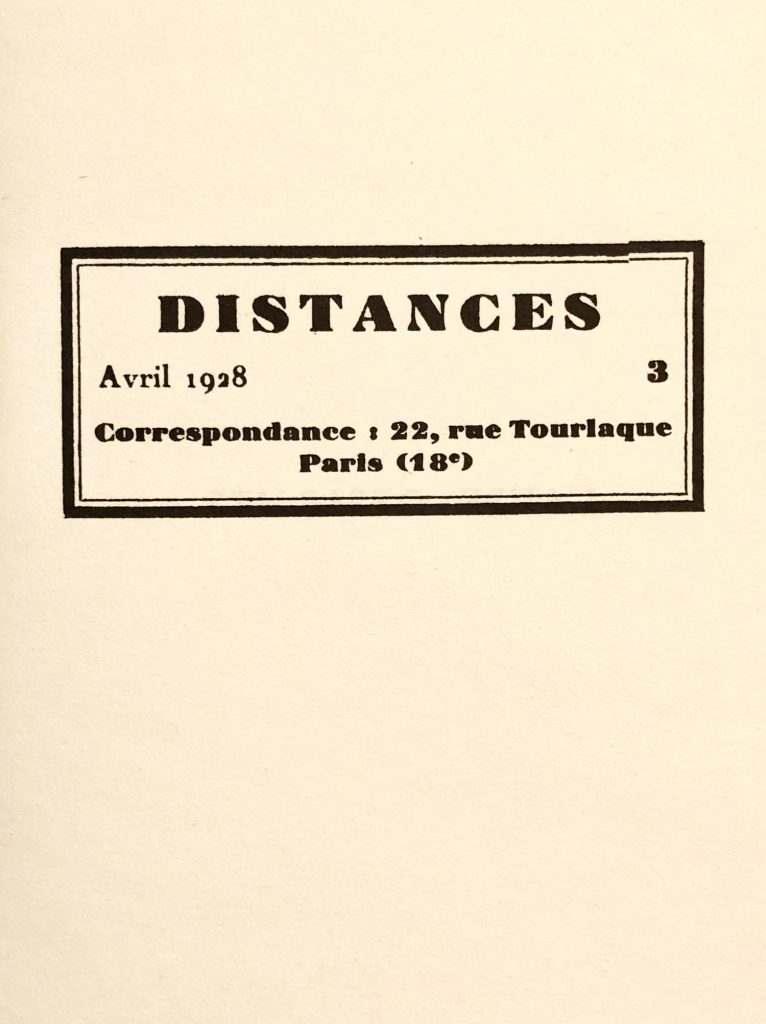
» Vivant depuis longtemps en ce pays sans ombre, chaque fois que le ciel cruel le vient menacer plus dangereusement, il invente aussitôt dans le sol de sa tête l’arbre qui le doit abriter.
Maintenant, recru de fatigue, il vous paraît enfin dormir, au péril entier du soleil. Mais d’artifice en artifice, il imite en secret les ruses du sommeil et veille, pour lui seul, à l’ombre de ses ruses. «
Gaston Dehoy
Le concerto est donc conçu comme une série de rêves dont le soliste est le principal rêveur. Les enregistrements sur le terrain qui s’estompent lentement contribuent au caractère onirique de l’œuvre, recontextualisant la musique dans une variété de paysages sonores. Plus de 300 fragments de texte parlé sont également intégrés à la musique. John a généré ces fragments à l’aide d’une chaîne de Markov pour manipuler le texte médical Insomnia; and Other Disorders of Sleep (1885) de Henry M. Lyman, un médecin connu pour son travail pendant la guerre civile américaine. John a enregistré les textes lui-même et les a édités de manière à ce que chaque phrase puisse être choisie individuellement et jouée par l’ordinateur dans n’importe quel ordre. Lors de la performance, le son de sa voix est modifié par un vocodeur qui harmonise son discours avec les harmonies changeantes de la musique.

L’Imitation du sommeil représente une évolution importante dans le travail de John Supko. En intégrant des éléments notés et électroniques dans un environnement homogène et en constante évolution, le logiciel qu’il a créé permet aux interprètes de répéter leurs parties de la même manière qu’ils prépareraient n’importe quelle œuvre notée. Chaque musicien reçoit un « patch d’entraînement » qui lui permet de répéter systématiquement toutes les parties notées pour son instrument. Les musiciens ont également la possibilité d’écouter le fichier sonore électronique correspondant (ainsi qu’un métronome) pendant qu’ils jouent. Lors du concert, les musiciens jouent donc des morceaux qu’ils ont préparés à l’avance. La seule variable est l’ordre dans lequel l’ordinateur leur demande de jouer ces parties, ou s’ils en joueront certaines ou non.
Ce texte de présentation provient du site web de John Supko